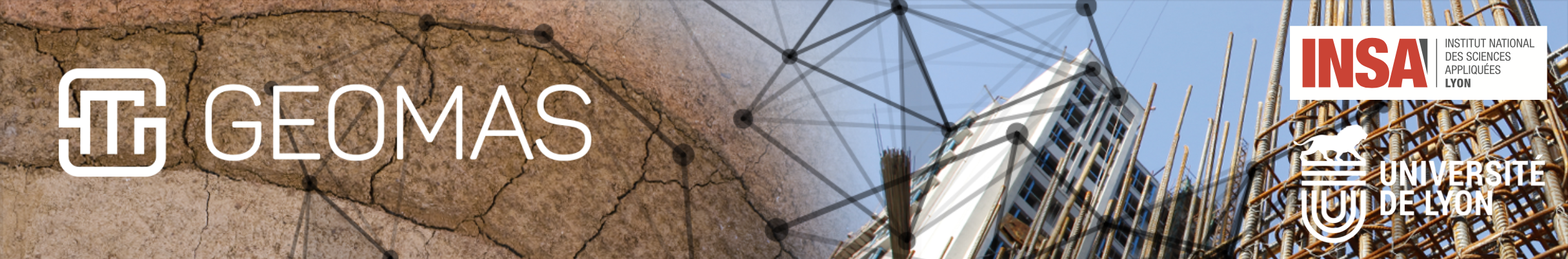Loading...
Bienvenue dans la collection HAL
du laboratoire GEOMAS - Géomécanique, Matériaux, Structure
Le laboratoire GEOMAS (Géomécanique, Matériaux, Structure) est une équipe d'accueil (EA 7495) de recherche sous la tutelle de l’INSA de Lyon.
Le laboratoire est situé sur le campus de Lyon-tech la Doua à Villeurbanne et regroupe des enseignants-chercheurs du Génie Civil et plus particulièrement de la mécanique des structures, des matériaux et de la géomécanique.
L’objectif du laboratoire est de mener une recherche académique d’excellence, adossée à une recherche partenariale, qui vise à répondre aux besoins industriels et sociétaux dans les domaines de la construction au sens large (géomécanique, matériaux et structures) en interaction avec leur environnement.
Dernières publications
-
Elodie Prud’homme, Fabien Delhomme, Clara Julliot, Loïc Corvalan, Sofiane Amziane, et al.. A New Experimental Setup to Characterize Binder–Vegetal Particle Compatibility in Plant-Based Concrete. Buildings, 2024, Advanced Concrete Materials in Construction, 14 (4), pp.1000. ⟨10.3390/buildings14041000⟩. ⟨hal-04535015⟩
-
-
-
-
-
-
Florian Tezenas Du Montcel, Sébastien Baguet, Marie-Ange Andrianoely, Régis Dufour, Stéphane Grange, et al.. Rubber part characterisation for rotordynamics analysis.. Surveillance, Vibrations, Shock and Noise, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace [ISAE-SUPAERO], Jul 2023, Toulouse, France. ⟨hal-04165670⟩
-
-
Jean-Baptiste Charrié, D. Bertrand, Cédric Desprez, Stéphane Grange. Vulnerability assessment of buildings based on the pseudo-dynamic testing method with sub-structuring: application to progressive collapse. 9th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis; M. Fragiadakis, Jun 2023, Athens, Greece. ⟨hal-04258693⟩
-
Thomas Lhermitte, Florent Prunier, David Bertrand, Stéphane Grange, Pierre Wyniecki, et al.. A 2D MACRO-ELEMENT FOR EFFICIENT NONLINEAR ANALYSIS OF PILE FOUNDATIONS UNDER SEISMIC LOADING. 9th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis; M. Fragiadakis, Jun 2023, Athens, Greece. ⟨hal-04258741⟩
Mots Clés
Ciment alumineux
Transient analysis
Finite elements
Wave Propagation
Bifurcation
74A30 nonsimple materials
Boucle de grains
Unbounded domains
BRIQUE
Finite element
Chape autonivelante
Sediment
Confinement
Bounded stiffness
Domain decomposition
Comportement sismique
Microstructure
BIOMATERIAU
Couple stress model
74J20 wave scattering
Subdomain coupling
CISAILLEMENT
Reinforced concrete
Clusters
Corresponding author
Comportement des structures
Ettringite binder
Dredged sediments
Cosserat continuum
Concrete
Materials
Cement
Composite
Contrainte mécanique
EXPERIMENTATION
Cinématique
Relaxed micromorphic model
Ciment riche en mayénite
74A60 micromechanical theories
Matériaux
Cinétique
SEDIMENT
Fissuration
Condensation statique
Cement rich in mayenite
Méthode des éléments discrets
Bâtiment
Composite coats
Matériau granulaire
DALLE
Dynamic behavior
Seismic behaviour
Interface
Finite element method
Chaine de forces
Anchor
Metamaterials
Génie civil
Granular material
Couplage
75J15 surface waves
Early age
ARGILE
Micromorphic continuum
Hydration
BENTONITE
BETON ARME
Anisotropy
Comportement dynamique
Enriched continua
74M25 micromechanics
Modeling
Band-gaps
Characteristic length
Size effects
Civil engineering
Modélisation
Building
Damage
74J10 bulk waves
74Q15 effective constitutive equations 1 Alexios Aivaliotis
Coupling
Wave-propagation
Generalized continua
Failure
Éléments finis
Béton armé
Wave propagation
Instability
Enriched continuum mechanics
COMPORTEMENT MECANIQUE
74B05 classical linear elasticity
Hydratation
CHARGE
Discrete element method
Endommagement
Plasticity
Shear
Cisaillement
74J05 linear waves
Actualités du laboratoire
Recherche
Notices
172
FullText
129
Répartition par type de document
Evolution des dépôts